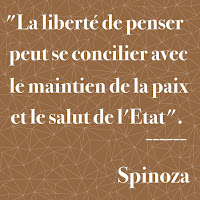Commentaire
Commentaire
Le Traité théologico-politique (1670) est un ouvrage du philosophe néerlandais d'origine portugaise Baruch Spinoza (1632-1677). En le publiant, Spinoza cherche à émanciper la raison de la tutelle théologique et, par conséquent, à permettre à chacun de pouvoir lire et comprendre les textes religieux. Il se fait le défenseur d'une théologie rationnelle, c'est-à-dire d'une exégèse biblique prenant appui sur la connaissance historique et sur la réflexion au moyen des lumières naturelles, dont l'objectif principal est la détermination de l'enseignement éthique qui s'y trouve.
Le texte ci-dessous est tiré du chapitre VII qui a pour titre : "De l'interprétation de l'Ecriture". Spinoza commence par reconnaître la valeur intrinsèque de l'Ecriture sainte en tant que parole de Dieu et enseignement de la voie menant au salut, c'est-à-dire à la vraie béatitude. Cependant, il s'empresse de constater que certains hommes ont tendance à remplacer cette parole par leurs propres inventions et à obliger les autres à penser comme eux. En ce sens, l'interprétation des textes religieux a un enjeu politique : certains individus cherchent à obtenir du pouvoir sur d'autres en instrumentant la religion à des fins personnelles. Spinoza propose justement une méthode pour se libérer de l'emprise de ces interprètes plus soucieux de l'obéissance de leurs ouailles que du contenu réel des textes sacrés.