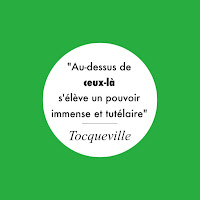1/ La société
1/ La société
« L'homme est par nature un animal politique ».
Aristote, La Politique.
« Celui qui est sans cité est soit une brute, soit un dieu ».
Aristote, La Politique.
« Ce qui donne
naissance à une cité, c’est l’impuissance où se trouve chaque individu à se
suffire à lui-même ».
Platon, La République.
« L’homme est un
loup pour l’homme ».
Hobbes, Léviathan.
« La plus ancienne de
toutes les sociétés et la seule naturelle est celle de la famille ».
Rousseau, Du Contrat
social.
« Chacun appelle
barbarie ce qui n'est pas de son usage ».
Montaigne, Essais.
« Tout être
raisonnable existe comme fin en soi et non pas simplement comme moyen ».
Kant, Fondement de la
métaphysique des mœurs.
« L'homme n'existe que
pour la société et la société ne le forme que pour elle ».
De Bonald, Théories du
pouvoir politique et religieux.
« Vices privés, vertus
publiques ».
Mandeville, La Fable
des abeilles.
« Ce n’est pas
de la bienveillance du boucher, du brasseur et du boulanger qu’il faut espérer notre
dîner, mais du souci de leur propre intérêt ».
Smith, Richesse des nations.
« Là où l’intérêt
règne seul, (…) chaque moi se trouve vis-à-vis de l’autre sur le pied de
guerre ».
Durkheim, De la
division du travail social.
2/ La justice et le droit
« Ce sont les
faibles, la masse des gens, qui établissent les lois (…) en fonction de leur
intérêt propre ».
Platon (exprimant la pensée du sophiste Calliclès), Gorgias.
« Ne pouvant
faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût
juste ».
Pascal, Pensées.
« La justice sans
la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. »
Pascal, Pensées.
« Plaisante
justice qu’une rivière borne ! Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur
au-delà ».
Pascal, Pensées.
« Le plus fort
n’est jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme sa force
en droit et l’obéissance en devoir ».
Rousseau, Du contrat
social.
« L’homme porte
en lui-même la justification principale de la propriété ».
Locke, Second traité
du gouvernement civil, chap. 5, §44.
« Si la justice
disparaît, c’est chose sans valeur que les hommes vivent sur terre ».
Kant, Métaphysique des
mœurs, « Doctrine du droit », II.
« La propriété,
c’est le vol ».
Proudhon, Qu’est-ce
que la propriété.
« L’équité (…)
donne de l’air à la justice ».
Jankélévich, Traité
des vertus.
3/ L’Etat
« En vérité, le but de
l'État, c'est la liberté ».
Spinoza, Traité
théologico-politique.
« Pour qu'on ne puisse
abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir
arrête le pouvoir ».
Montesquieu, L'Esprit
des lois.
« Les hommes
doivent être caressés ou anéantis ».
Machiavel, Le Prince.
« Aussi longtemps
que les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les tienne tous en respect,
ils sont dans cette condition qui se nomme guerre, et cette guerre est guerre
de chacun contre chacun ».
Hobbes (décrivant la situation à l’état de nature), Le Léviathan.
« Les ouvriers
n’ont pas de patrie ».
Marx, Manifeste du
parti communiste.
« Cette sorte de
servitude réglée, douce et paisible (…) à l’ombre même de la souveraineté du
peuple ».
Tocqueville, De la
démocratie en Amérique, II, 4, 6.
« L’État, c’est
le plus froid de tous les monstres froids : il ment froidement et voici le
mensonge qui rampe de sa bouche : ‘‘Moi, l’État, je suis le Peuple’’. »
Nietzsche, Ainsi
parlait Zarathoustra, « De la nouvelle idole ».
« La guerre,
c’est la continuation de la politique avec d’autres moyens ».
Clausewitz, De la
guerre.
« Le pouvoir sans
l’abus perd le charme ».
Valéry, Cahier B.
« Résistance et
obéissance, voilà les deux vertus du citoyen. Par l'obéissance, il assure
l'ordre, par la résistance, il assure la liberté ».
Alain, Propos.
« Tout pouvoir sans
contrôle rend fou ».
Alain, Propos.
« On ne fait pas
de politique avec de la morale, mais on n'en fait pas davantage sans ».
Malraux, La Condition humaine.